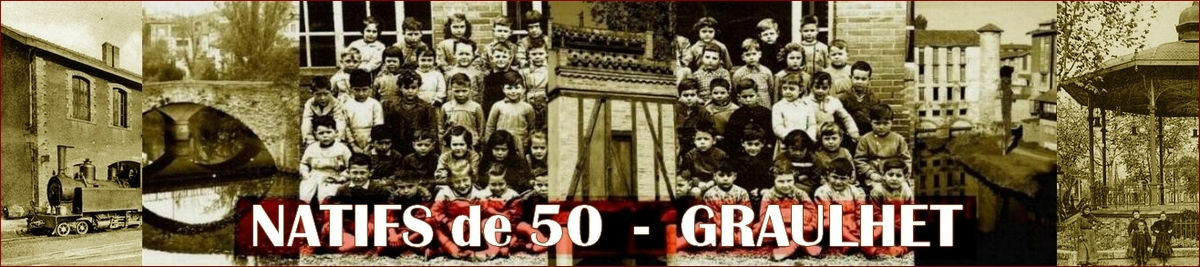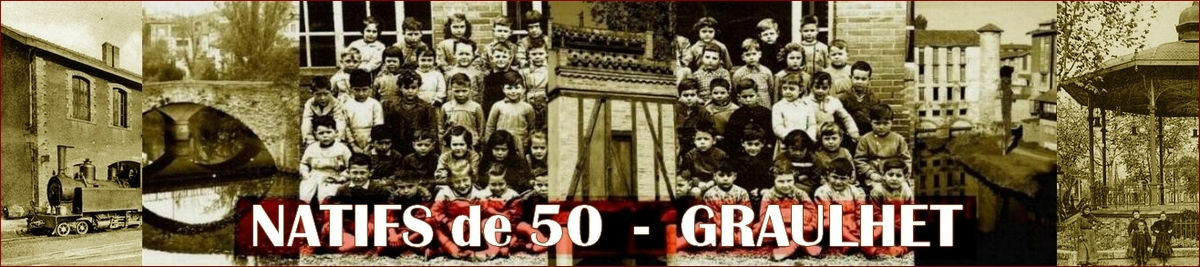Trésors d’archives : Le cuir à Graulhet
Trésors d’archives : Le cuir à Graulhet

La Dépêche du Midi a lancé récemment une série "Trésors d’archives", qui retrace les grandes heures de l’histoire du Tarn, réalisée en collaboration avec les archives départementales.
Publié le 07/02/2025 | La Dépêche du Midi | Vincent Vidal
Trésors d’archives : Quand l’industrie du cuir et Graulhet ne faisaient qu’un

Les ouvriers d’une mégisserie au début du XXe siècle. / DDM
Dans le cadre de notre série Trésors d’archives, qui retrace les grandes heures de l’histoire du Tarn, nous revenons sur ces mégisseries qui ont fait la fortune de Graulhet, avant de connaître de grandes crises sociales et économiques.
Mazamet avait sa laine, Carmaux son charbon, Gaillac son vin et Graulhet son cuir. Une production qui a marqué le quotidien du bassin durant plusieurs siècles. Tout a commencé au XVIIe. La ville voit se développer les activités d’artisanat autour du tannage, de la cordonnerie, chapellerie et de la tannerie. Déjà un tiers de la population travaille dans ces productions. Et cela ne fait que commencer.

Le long du Dadou de nombreuses mégisseries entourent l'ancien moulin de la ville
Graulhet à la chance de posséder plusieurs cours d’eau dont le Dadou, qui permettent de laver les peaux avant de les travailler. Autre élément capital pour le développement, la proximité de Mazamet qui travaille la laine et permet d’acheter de grosses quantités de peau, directement dans le Tarn.
Au fil des décennies, l’industrie continue de prospérer et se dirige de plus en plus vers la mégisserie. Cela consiste au tannage des peaux d’ovins et caprins destinées à l’industrie de la chaussure, de la ganterie ou de l’habillement. La cité se modernise pour faire face à l’augmentation des carnets de commandes.

Les femmes travaillant dans les usines, ont toujours été en première ligne, durant les grèves. / DDM
En 1895, le bassin est enfin raccordé au réseau ferroviaire national, via une ligne à petit écartement, exploitée par la Compagnie des chemins de fer à voie étroite du Tarn, en direction de Laboutarié. Une seconde à destination de Lavaur sera inaugurée en 1903.
147 jours de grève
Tout va pour le mieux ? Pas vraiment. Face à cette réussite économique, les ouvriers exploités réclament des avantages. Nous sommes dans une époque où le syndicalisme prend une place majeure dans le pays. Les grèves s’accumulent et se durcissent. C’est le cas à Graulhet. Travailler dans la mégisserie est très usant.

Jean Jaurès qui arrive à Graulhet pour défendre les ouvriers lors de la grande grève de 1909. / DDM
Voilà ce qu’en dit Jean Jaures lors d’un discours. "Il s’agit d’une industrie parfois malsaine, toujours malpropre, où les ouvriers manient des substances répugnantes, des substances putrides, d’une odeur nauséabonde, intolérable.
Ils manient en outre des substances chimiques qui sont nuisibles à la santé. Ils absorbent des émanations d’arsenic. Il leur arrive alors de n’avoir pas le temps, dans le quart d’heure qui leur est donné, de se laver, de se nettoyer, de prendre les précautions de propreté sans lesquelles l’homme mange comme une bête."

Les ouvriers en grève en 1909./ DDM
Entre 1880 et 1910, on ne comptera pas moins de 13 grèves. Le conflit le plus long durera 147 jours, de 1909 à 1910, mobilisant la totalité des ouvriers de l’époque, soit 1 800 grévistes. Après une bonne production sur l’année 1909, les syndicats encouragent les salariés à demander de meilleurs salaires et des baisses d’horaires. Face au refus des patrons, la grève débute.
Le 24 janvier 1910, une usine est incendiée. Pour les grévistes, voir certaines usines continuer à tourner, alors que la lutte bat son plein, est insupportable. Ils s’efforcent par tous les moyens d’empêcher les peaux venues de Mazamet, d’entrer dans les ateliers.
Rapidement, des convois sont stoppés et sommés de repartir à la gare. Parfois, les peaux sont même détruites. Face à cette violence, plusieurs bataillons d’infanterie et de cavalerie vont être envoyés sur place. Au total, près de 3 000 soldats et gendarmes stationneront dans la ville, durant le conflit.

Les enfants des grévistes sont envoyés à Mazamet pour éviter la misère et la faim. / DDM
L’exode des enfants pour éviter la misère et la faim
Face à la misère et à la famine qui s’installent, les enfants des grévistes sont envoyés dans des familles des villes voisines solidaires de la grève, comme à Mazamet ou Carmaux. Mais, au fil des jours, le froid et la faim finissent par faire céder les grévistes. Ces perturbations politiques portent un grand coup à l’industrie du cuir.
Le renouveau vient lors de la Première Guerre mondiale, avec la fabrication de chasubles pour les soldats français. Après avoir équipé l’aviation militaire durant la guerre, les cuirs de Graulhet servent à équiper les aviateurs civils.
D’autres secteurs s’intéressent à ce savoir-faire tarnais. En 1930, les sapeurs-pompiers de Paris s’équipent de leurs vestes en cuir. La production est alors au plus haut. À cette époque, l’industrie du cuir occupe toujours une place centrale, avec 95 mégisseries et 3 500 ouvriers.

La gare de Graulhet verra le trafic ferroviaire disparaître en 1937
En 1937, on démonte les voies ferrées
Ombre au tableau, la crise financière de 1929 touche la mégisserie, fortement dépendante des échanges de peaux avec l’Australie, l’Argentine et l’Afrique. La compagnie de chemin de fer, elle, ferme la dernière liaison en 1937 et les voies sont entièrement démontées. Graulhet n’a plus alors de réseau ferroviaire.
Les années passent et la mégisserie continue de faire vivre le bassin. Les usines tournent de nouveau à plein régime et les ouvriers peinent à satisfaire la demande durant la Seconde guerre mondiale. Les célèbres vestes de char modèle 39 sont confectionnées à plusieurs milliers d’exemplaires. Sur une photo, Charles de Gaulle, apparaît dans une tenue produite à Graulhet devant son régiment de chars.
L’après-guerre continue de générer des bénéfices. La filière compte alors plus de cent mégisseries, 4 000 ouvriers et réalise un chiffre d’affaires de 500 millions de francs.

Avec la crise économique, les friches industrielles se sont multipliées à Graulhet. / DDM- JEAN-MARIE LAMBOLEY
La fin de l’époque bénie
Durant les "Trente Glorieuses", les ouvriers se tournent vers d’autres secteurs d’activité moins pénibles. Pour pallier cette situation, les patrons engagent des travailleurs immigrés pour les remplacer.
Les patrons continuent de diriger d’une main de fer la ville dans tous ces secteurs, même l’éducation. Graulhet sera la seule cité de plus de 10 000 habitants à ne pas posséder de lycée d’enseignement général jusqu’en septembre 2023. Les grands mégissiers préférant des filières professionnelles, plus facile à embaucher et à fidéliser.

Le cuir de Graulhet repart dans la course / DDM
Les temps changent. La concurrence se fait plus rude avec l’arrivée de la Chine qui casse les prix sur le marché international. Face à cette nouvelle évolution commerciale, les faillites des mégisseries se multiplient, le chômage aussi.
Les friches industrielles deviennent légion. C’est la fin de l’époque bénie, même si aujourd’hui, la production du cuir n’a pas disparu et que quelques sociétés ont su évoluer et résister, démontrant que même au XXIe siècle, le cuir et Graulhet ne font qu’un.

Mégissiers, tanneurs et maroquiniers ouvrent les portes au grand public lors de l'opération «Cuir dans la peau» en octobre / DDM

Cuir Graulhet : Images contemporaines
 L'ancien mégissier donne une deuxième vie aux cuirs : François Austruy a créé il y a quelques années son entreprise Cuir en Stock / DDM, GD
L'ancien mégissier donne une deuxième vie aux cuirs : François Austruy a créé il y a quelques années son entreprise Cuir en Stock / DDM, GD

Cuirs du futur, la mégisserie graulhetoise qui s’expose à l’Elysée / DDM, EC

Jean-Claude Milhau : L’un des derniers maroquiniers indépendants est installé à Saint-Julien-du-Puy. Il vend ses propres créations dans sa boutique./ DDM, MA

François Roques : à Graulhet, les baskets en cuir sont de bon thon / DDM, RB

Une retraite bien méritée pour Odile après 43 ans chez Frandi / DDM, PA

Mise en lumière de la filière graulhétoise : La 8e édition de "Graulhet, le cuir dans la peau" a été lancée chez Bandit Manchot / DDM, PA

"Des sacs adaptés au goût des jeunes". Quand le chemin des écoliers fait un détour par Graulhet (Chez School Pack) / DDM, MPV

Graulhet, l’industrieuse au glorieux passé : À Graulhet, la Maison des métiers du cuir est un incontournable. / DDM

Prix international pour le cuir papier froissé d’Hiriar / DDM, PA

La Maison des métiers du cuir a trouvé son public (ancienne mégisserie de Darius Fabre) / DDM, MMC

Pour Noël, la ville de Graulhet annonce la filière cuir / DDM

Briatexte : La maroquinerie Serres propose ses articles "Made in Tarn" / DDM

À l’Atelier Cuir de Graulhet, une unité de production relocalisée dans le Tarn, va confectionner des vestes pour d'emblématiques marques du luxe dans le monde. / RB

Les entreprises qui travaillent le cuir ouvrent exceptionnellement leurs portes et acceptent de faire visiter leurs ateliers. / DDM, EC

2023 : Pour la septième année, l’Office de Tourisme La Toscane Occitane organise les journées portes ouvertes « Graulhet, le cuir dans la peau ! ». / DDM

Avec 12 000 colis par an, à Graulhet, la maroquinerie Made in Tarn cartonne sur internet / DDM

La mode du "Made in France" relance la filière cuir dans le Tarn / DDM

Graulhet est la seule ville de France où l’ensemble de la filière cuir est présente. / DDM
Partagez sur les réseaux sociaux
Catégories
Autres publications pouvant vous intéresser :
Commentaires :
Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !