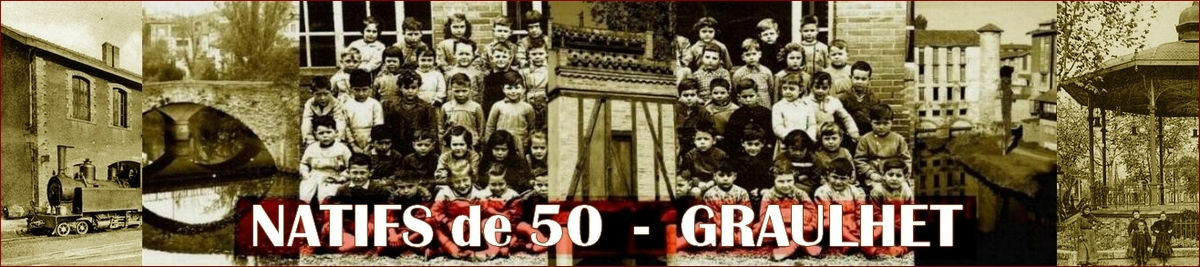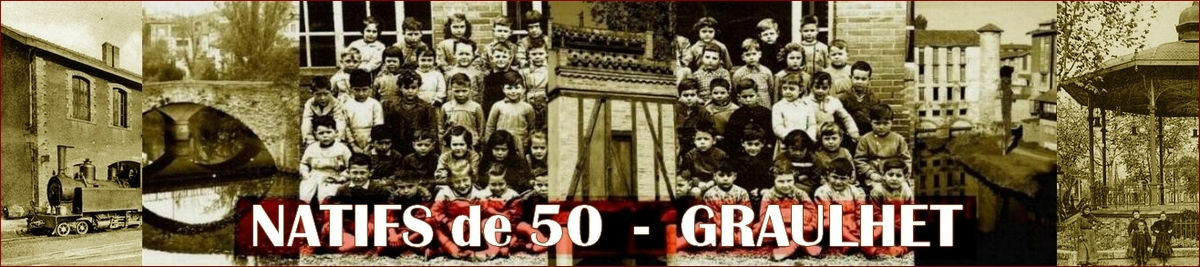Création du département du Tarn

Contour du département du Tarn en 1790
Pendant la révolution française, le département d'Albigeois créé en 1790 est rapidement renommé Tarn en référence à la rivière principale qui le traverse. En vertu de la loi du 28 pluviôse an V, les départements de l'Hérault et du Tarn ont échangé le canton d'Anglès qui faisait partie du diocèse de Saint-Pons, et le canton de Saint-Gervais-sur-Mare qui faisait partie du diocèse de Castres. Castres en est la préfecture jusqu'en 1795. À cette date, la tiédeur révolutionnaire convainc les décideurs de confier la préfecture à Albi. En dépit de plusieurs demandes de Castres pour récupérer la prééminence administrative, la décision restera. (Source Wikipedia)

Le département, créé en 1790, sans véritable conflit de tracé, traverse la Révolution sans l’influencer. Si quatre députés votent la mort du roi, quatre préfèrent le sursis ou le bannissement. Département médian, il fait déjà figure de modéré et ne compte que douze exécutions pendant la Terreur. La période avive une rivalité durable entre Castres et Albi pour le chef-lieu. Castres, plus peuplée et patriote, l’emporte d’abord, mais Albi prend sa revanche définitive en 1797.
L’antagonisme se manifestera dans les choix politiques. Le nord évoluera vers les idées libérales, républicaines et socialistes. Le sud demeurera longtemps un bastion conservateur, même si l’école de Sorèze, dirigée jusqu’en 1861 par Lacordaire, représente, avec son enseignement des langues vivantes, des sciences et la pratique du sport, un exemple de modernité pédagogique.

Si le Sud-Ouest manque sa révolution industrielle, le Tarn y entre de plain pied avec ses deux bassins : au nord, Carmaux (mineurs) et Saint-Juéry (sidérurgistes) ; au sud, le Castrais (textile) et Mazamet (délainage, dès 1850). Avec les usines, vient le temps des luttes sociales. Jaurès est élu député en janvier 1893, contre le marquis de Solages, propriétaire des mines de Carmaux. Le Tarn, dans ses rues et places, garde au cœur la plus grande voix, la plus belle plume du socialisme français. Il reste, avec le peintre Toulouse-Lautrec, le Tarnais le plus connu. (Source : tarn.fr)
Publié le 21/03/2015 à 07:38 | La Dépêche du Midi | Daniel Hourquebie
Départements : 230 ans d'histoire !

Les 83 départements créés en 1790 (le Tarn & Garonne n'existe pas encore) / Wikipedia
Le département, quelle histoire ! Et sans doute, quel avenir. Dans une société fracturée par la perte de repères, et le délitement du lien social, on doit mesurer l'importance d'une entité qui suscite encore aujourd'hui un si fort sentiment d'appartenance, et qui – même si les esprits forts en ricanent – structure des identités positives qui ne se fondent pas sur le rejet de la province voisine.
Pas si courant dans nos sociétés modernes, travaillées au corps par de fort méchantes forces centripètes, où l'exclusion voire la haine, empoisonnent l'idée tranquille d'identité.

Splendide méandre du Tarn autour du village d'Ambialet. / Photo DDM
Missions emblématiques
Dans l'idée de département, sauf exception évidemment – et il y en a forcément –, on est plutôt normalement dans le vivre ensemble et le lien social, à l'image de ses missions emblématiques maintenues pour l'essentiel ar le législateur : l'action sociale, le collège, la voirie, la culture. Sa pérennité n'était pas pour autant acquise lors de sa création en 1790. Inspirée de la citation de Mirabeau, ténor de la révolution, qui évoque un royaume «agrégat inconstitué de peuples désunis».

Sainte-Cécile à Albi : Cette espèce de vaisseau posé en ville est impressionnant / DDM
Le peuple ou plutôt les peuples vivent alors dans des provinces aux frontières imprécises et ne parlent pas la même langue. L'administration des intendants a gardé les stigmates de l'ancien régime. La Révolution doit alors trouver une organisation administrative efficace avec des frontières identifiées.
L'instauration des préfets par Napoléon va ensuite structurer pour presque deux siècles le pouvoir vertical de l'Etat (plus ou moins rigide selon les individus et les époques) avant l'émancipation du département, devenu collectivité locale autonome avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. La loi du 2 mars 1982 transfère le pouvoir exécutif des mains du préfet à celui de président du conseil général. Il était temps.

Comtés du Languedoc en 1209 / Wikipedia
Un découpage très à cheval
On mesure le chemin parcouru. Mais le département revient déjà de loin. Artificiel peut-être, mais il a quand même échappé au découpage géométrique «à l'américaine» auquel avaient d'abord songé les révolutionnaires. La France aux identités et à la géographie complexe n'est pas le middlewest désertique américain. Et son territoire méritait plus de nuances qu'un découpage à la règle, «tout dret» !
En 1790, quand la création des départements est adoptée par l'Assemblée Constituante, ils sont donc au nombre de 83, organisés autour d'un chef-lieu accessible des quatre coins du département en moins d'une journée à cheval. Aujourd'hui, on calculerait plutôt en journée de drone. Leurs noms sont choisis en fonction des fleuves et des massifs montagneux présents sur leur territoire.

Les eaux de la Montagne Noire alimentent le Canal du Midi / Photo DDM
Le citoyen se coule dans le moule
Le département va s'enraciner dans l'esprit des citoyens car il ne va pas seulement servir de support à l'organisation purement administrative. C'est toute la vie politique, économique et sociale, culturelle, sportive, associative, éducative qui se coule dans le moule.
Au fil du temps, les organisations les plus diverses, politiques, professionnelles, consulaires, syndicales, associatives, culturelles, et plus tard sportives s'organisent au niveau départemental.

Lacaune sous la neige / Photo DDM, C. Calas
Solidarité... et parité
Le département fait consensus et encore davantage durant la IIIe République où il s'ancre au cœur des institutions. Craint-on un coup de force politique ? Le département sauvera la République. On a trop oublié aujourd'hui la loi du 15 février 1872 qui prévoit que «si l'Assemblée nationale venait à être illégalement dissoute», les conseils généraux «s'assemblent immédiatement et sans qu'il soit besoin de convocation».
Aujourd'hui encore, le conseil départemental se pose finalement en rempart de la République. Pas forcément sur le plan institutionnel (on espère qu'elle n'est pas menacée) mais au niveau des valeurs que cette collectivité véhicule dans son identité et ses missions prégnantes axées autour de la solidarité. Avec désormais la parité qui fait rentrer le nouveau conseil départemental dans l'ère moderne.
Publié le 28/06/2019 à 10:47 | La Dépêche du Midi | LAGARRIGUE Max
Tarn et Garonne : L’un des plus petits départements de France

Le département du Tarn et Garonne ne fut créé qu'en 1808
Riche de ses saveurs et de sa culture, le Tarn-et-Garonne est l’un des territoires les plus attractifs du Midi toulousain.
Avec au centre ses plaines alluvionnaires de la Garonne et son affluent le Tarn, à l’Est la vallée de l’Aveyron et ses fameuses gorges de Saint-Antonin-Noble-Val à Bruniquel, au Sud ses terres argileuses et vallonnées de la Lomagne, et au Nord son plateau calcaire du Quercy, le Tarn-et-Garonne est un département de contraste.
Et pour cause. Oubliée des députés de la Constituante lors du découpage de 1790 portant la création des départements, Montauban, feu puissante capitale de la généralité de la Haute-Guyenne, est réduite au rang de sous-préfecture du Lot. Une situation humiliante pour la troisième ville du Sud-Ouest à laquelle le maire de l’époque, Pierre-Joseph Vialètes de Mortarieu, un bonapartiste de la première heure, fait tout pour y remédier.

À peine élu, il se rend, en 1806, avec une délégation montalbanaise au château de Saint-Cloud pour plaider la cause de sa ville à l’empereur. Il lui faut toutefois patienter encore deux ans pour que Napoléon en déplacement dans le Sud-Ouest, fasse un détour par Montauban le 29 juillet 1808, et donne gain de cause à ses habitants. Si l’histoire locale ne conserve que le souvenir de Napoléon posant sa main sur une carte pour en faire le contour avec un crayon, délimitant ainsi les frontières du nouveau département, il ne fait pas de doute que la création du Tarn-et-Garonne est née du grignotage de six départements voisins.
Une singularité historique qui explique la diversité de ses paysages. Cette construction dix-huit ans après le découpage de la Constituante, n’est toutefois pas si artificielle qu’il n’y paraît. Le département qui a la forme d’un Y semble épouser les axes de communications ouest - sud et nord - sud. Des voies qu’emprunte aujourd’hui l’autoroute A62 reliant Bordeaux à Toulouse, et jadis la RN 20 doublée de l’A20 entre Toulouse et Paris.

Faire son marché en quête de bons produits locaux / DDM
Un département riche de saveurs
Un département carrefour qui foisonne de richesses architecturales (les châteaux médiévaux de Bioule, Brassac, Bruniquel, Cas, Gramont, Saint-Projet) d’édifices religieux (abbayes de Moissac, Belleperche et Beaulieu), d’artistes et intellectuels (Fermat, Lamothe-Cadillac, Ingres, Bourdelle, Olympe de Gouges, Roda-Gil, Téchiné, Perret, Labro), agricole avec son chasselas de Moissac, sans oublier le fabuleux patrimoine de génie civil qu’est le canal latéral à la Garonne.
Un département riche de ses saveurs et de sa culture qui en fait l’un des territoires les plus attractifs du Midi toulousain et le troisième de France en gain démographique. Sa population dépasse les 256 879 habitants (dernier chiffre Insee 2019), soit + 1 % sur la période 2011-2016, c’est plus que la région Occitanie (+0,8 %) et la France métropolitaine (0,4 %) sur la même période.

Le cloître de Moissac / DDM