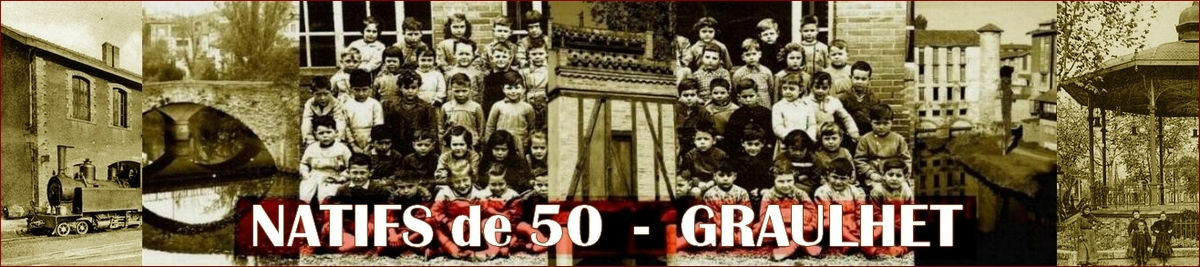
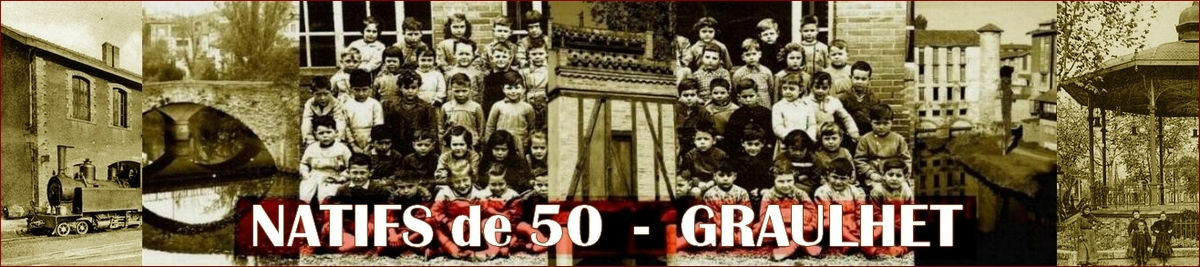
Haut-Languedoc d'antan
(3ème partie)

3 - Quelques métiers souvent disparus

De nombreux métiers très répandus au début du XXème siècle ont disparu de nos jours ou ont tellement évolué qu'ils ne se pratiquent plus de la même façon : colporteur, cloutier, porteur de glace, sabotier, feuillardier, chanvrier, etc... En voici quelques-uns qui étaient très courants dans nos montagnes tarnaises. Selon son secteur d'activité, parfois l'artisan se déplaçait de village en hameau, parfois il possédait une petite échoppe dans l'un des bourgs du secteur...

Dans nos campagnes en général, il y avait peu d'argent liquide qui circulait, et jusqu'à la guerre de 14 le troc était largement pratiqué : pommes de terre contre vin, jambons en échange de tissus,... Dans les fermes, chaque paysan disposait d'un minimum d'outillage et profitait notamment de l'hiver pour réparer ses ustensiles de travail ou en confectionner de nouveaux. Ce fonctionnement s'inscrivait dans un mode de vie axé sur l'autarcie, et c'était autant de dépenses en moins, que l'on n'aurait d'ailleurs pas pu payer...

Les journaliers :
Il existait à l'époque de nombreux journaliers, souvent jeunes et illettrés et ne possédant ni terres ni maison. Ils allaient travailler à la journée tantôt chez l'un tantôt chez l'autre, étaient nourris mais maigrement rétribués. Souvent les propriétaires leur octroyaient un lopin de terre sur lequel ils pouvaient semer des pommes de terre ou des légumes qu'ils récoltaient en automne, et en échange ils s'engageaient à travailler gratuitement pendant un certain nombre de journées...

Les saisonniers :
Il existait à Anglès un marché particulier, celui de la main d'oeuvre saisonnière. Tous ceux qui voulaient s'embaucher pour les grands travaux d'été, "l'estibade", se rassemblaient sur la place un dimanche de juin, le jour de la louée. Les garçons portaient une faux sur l'épaule, quant aux filles (servantes, bergères) elles étaient peu nombreuses. Les cultivateurs faisaient alors leur choix ; une fois l'accord conclu le nouveau patron offrait à boire à son "estibandier" qui partait ensuite danser. Cette journée se terminant par un bal est à l'origine de la fête actuelle locale...

Les scieurs :
La forêt, richesse de la montagne, était source de nombreux métiers liés au travail du bois. A l'époque les résineux n'avaient pas encore envahi les croupes tarnaises, et les arbres les plus recherchés étaient le chêne et le hêtre selon l'altitude. Quand les troncs coupés par les bûcherons ne pouvaient être apportés à la scierie, ils étaient sciés sur place pour être transformés en poutres, solives ou planches. Les scieurs étaient souvent itinérants et se déplaçaient dans la contrée avec leurs outils sur l'épaule à la recherche de nouveaux chantiers. En raison de la neige, ils étaient soumis l'hiver à une longue période d'inactivité...

Les charbonniers :
Le charbon de bois, fréquemment utilisé en ville pour le chauffage et la cuisson, était fabriqué en général entre juin et septembre afin que les charbonnières ne soient pas dégradées par le mauvais temps. Sur une aire plane bien dégagée, des bûches étaient empilées verticalement autour d'une colonne servant de cheminée, réalisant plusieurs cercles et plusieurs étages. Quand le dôme de bois était terminé, le charbonnier le recouvrait d'herbe bien tassée pour étanchéiser l'ensemble. Après la mise à feu, la carbonisation pouvait durer jusqu'à une semaine et l'équipe se relayait jour et nuit pour maintenir un tirage régulier. Il fallait une tonne de bois pour obtenir environ 200 kg de charbon...

Les cercliers ou feuillardiers :
Le feuillard était obtenu à partir d'une pousse de châtaignier de 4 à 5 ans. Il fallait tout d'abord réaliser ces feuillards : les tiges étaient fendues sur toute leur longueur, avant d'être rendues flexibles à l'aide d'un chevalet puis cintrées. Ils étaient principalement fabriqués pour ceinturer les barriques (il en fallait jusqu'à 24 par tonneau), pour réaliser des baquets, des casiers à écrevisses ou des nasses à poissons...

Les boisseliers :
La plupart des personnes travaillant dans les bois érigeaient une hutte rudimentaire dans laquelle ils travaillaient et vivaient. Le boisselier fabriquait des outils ou des ustensiles en bois que les paysans utilisaient dans la vie quotidienne ou pour les travaux agricoles. A partir de bois spécialement sélectionnés selon l'outil à réaliser, il confectionnait fourches, rateaux, pelles,...

Les ardoisiers :
Le sous-sol de la région était également source d'emplois, avec notamment la présence de nombreux filons de schiste qui allaient fournir à la construction les ardoises des toits et des murs. Maintenant plus industrialisé et mécanisé, le travail était autrefois très artisanal et se déroulait en général sur la carrière même. A l'aide d'une masse et d'un burin, l'ardoisier débitait des feuilles dans un bloc ; ensuite, à l'aide d'une petite enclume, elles étaient façonnées à la forme et à la taille voulues...

Les carriers :
Dans le Sidobre, les carriers construisaient leur atelier sur l'emplacement même du lieu d'extraction afin de limiter le déplacement de blocs très lourds. A l'intérieur, une forge rudimentaire permettait l'affutage régulier des outils. Les rochers étaient découpés en respectant le fil de la pierre, verticalement puis horizontalement, à l'aide de ciseaux repasseurs, de poinçons plats et du marteau "à boucharder". Le granit déjà fortement recherché pour la confection de tombeaux allait connaître un essor important après la première guerre mondiale pour la réalisation de monuments aux morts...

Les fileuses :
Un autre matériau disponible jadis en grande quantité sur place,la laine des moutons, était souvent travaillée au sein même de la famille. On disait que "la laine paie la rente du fermier". Donc on faisait souvent davantage cas de la toison que de l'animal qui la portait : on s'attachait à accroître l'effectif du troupeau, plutôt qu'à améliorer la qualité des animaux. Dans la plupart des maisons la laine des ovins était filée pour son propre compte...

Les brodeuses :
Dans la région, la tradition textile est très ancienne : on trouvait la matière première sur la montagne, la force motrice et la population ouvrière dans la vallée. Laines, tissus et draps étaient alors produits dans des petites structures familiales, qui par la suite ont été supplantées par la grande industrie. Ainsi la grosse laine du pays a été remplacée par la laine étrangère, et son prix a donc fortement décliné..

L'industrie textile :
Les vallées de l'Agout, de l'Arnette et du Thoré ont attiré de nombreuses usines textiles, alimentées par des eaux abondantes et de bonne qualité. Activité principale des artisans et des marchands du moyen-âge, l'essor du textile a été impulsé par Colbert qui créa de nombreuses manufactures royales et imposa des normes de qualité. Tout au long du XIXème siècle l'industrie textile s'eet développée en qualité et en quantité, et des unités de fabrication se sont implantées dans le moindre village : Labastide-Rouairoux ( filature et tissage), Roquecourbe (tricotage et bonneterie), Dourgne (effilochage), Brassac, Vabre, Labessonnié,...

Le maréchal-ferrant :
L'abondance des animaux de trait nécessitait la présence sur place d'artisans capables d'assurer les soins de base ou les pièces nécessaires à leur fonction. Aussi trouvait-on dans chaque village ou hameau un "féradou" à l'intérieur duquel on pouvait immobiliser vache, mule ou cheval afin de changer leurs fers. Revêtu d'un grand tablier de gros cuir, le maréchal-ferrant naviguait entre les pattes de l'animal et son enclume où il ajustait le fer à la morphologie de la bête...

Le forgeron :
Le maréchal-ferrant était donc en même temps forgeron, et son activité allait bien au-delà du ferrage des animaux. Tout le village vivait au rythme des coups martelés avec vigueur et en cadence sur l'enclume ! Le forgeron réparait ou fabriquait tous les accessoires métalliques nécessaires aux travaux des champs, ou indispensables à la vie domestique. Il pouvait donc tout aussi bien réaliser un soc pour la charrue qu'une crémaillère pour l'âtre. Sa forge, enfumée et bruyante, était aussi un lieu de rencontre recherché par les habitants du village ou les gens de passage. Au début du XXème siècle, il était souvent "payé" grâce au troc : le meunier avec de la farine, l'éleveur avec un saucisson, l'agriculteur avec des pommes de terre,...

Le bourrelier :
C'est à lui que revenait de fabriquer tout ce qui était nécessaire pour atteler les animaux. Un métier indispensable dans le mode traditionnel rural et les transports d'antan, incontournable aussi bien en ville qu'à la campagne. Il réparait et confectionnait les bâts et les harnais, les colliers et les guides, il "habillait" chevaux et "voitures". En principe, il disposait d'une boutique sur rue et d'un atelier sur cour dans lequel il entreposait et travaillait les différents matériaux qu'il utilisait : cuirs, bois, toiles, sangles, boucles, anneaux, mors, grelots,... Des tissus (feutre, toiles, moleskines,...) y côtoyaient les matériaux de rembourrage (paille, crin, bourre). Toutes sortes d'outils spécifiques étaient accrochés aux murs, à côté des établis, patrons et machines à coudre...

Le charron :
Il était présent dans le moindre village de la France profonde. Jusqu'à la dernière guerre, la charrette tirée par des bovins ou des chevaux, la calèche ou la diligence, étaient réalisées sur place. Le travail était assuré par un ou plusieurs charrons dans chaque village. Le principal matériau du charron était le bois, provenant d'arbres abattus avant l'hiver : acacia et chêne pour les roues, orme pour le moyeu, chêne pour les parties exigeant une solidité à toute épreuve, frêne, sapin ou hêtre pour les autres pièces moins exigeantes. Alors qu'il n'existait pas de charron à Anglès au début du XIXème siècle, "l'amélioration" du réseau routier conduisit à fabriquer des charrettes et des voitures pouvant rouler "vite". Vers 1900, on comptait 5 charrons dans cette commune, dont un dans le hameau de La Souque...

Les porteurs de glace :
Dans le village audois de Pradelles-Cabardès, en hiver, les paysans récupéraient de la neige au Pic de Nore et la descendaient en charrette jusqu'à des "citernes" enterrées : les glacières. Ils tassaient cette neige avec leurs sabots et la recouvraient d'une couche d'un mètre de feuilles de hêtre. Ainsi préservée, la glace se conservait jusqu'en octobre ! Ils taillaient ensuite cette glace à coups de pioche, et la plaçaient dans des moules circulaires d'un mètre de hauteur. Ces "balles" de glace étaient alors livrées en charrette dans la plaine audoise, et notamment sur Carcassonne ; plus tard chemin de fer et canal du midi permirent de livrer vers le Tarn et l'Hérault. Le dernier "glacier" officia jusqu'en 1925...

Les vendangeurs :
A la saison, les paysans de la montagne allaient chercher un peu d'argent et de dépaysement dans le "pays bas" de la plaine languedocienne pendant la saison des vendanges. Plusieurs habitants des villages, appelés chefs de "cole", se chargeaient de recruter le personnel nécessaire pour assurer la récolte dans un gros domaine viticole. Le trajet vers le Minervois, Béziers ou Saint-Chinian s'effectuait au début à pied, plus tard en charrette. Les hommes en général s'engageaient comme porteurs, les femmes et les enfants (dès 8 ans) comme coupeurs.

Les vendangeurs :
Si le travail était dur, cette période constituait pour beaucoup un changement de vie et l'occasion de goûter à des plaisirs faciles que dénonçaient les prêtres de la montagne dans leurs sermons ! Les jeunes, loin des parents restés à la ferme pour s'occuper du bétail, considéraient en effet cette escapade (souvent l'unique de l'année) comme un semblant de vacances en dépit de l'exigence du travail. La rémunération avait été fixée à l'avance, et l'on dormait dans le foin des granges. Les vendanges finies, on remontait aussitôt pour achever les semailles du seigle...

4 - Les déplacements

Le réseau routier du Haut-Languedoc à l'aube du XXème siècle ressemblait dans ses grandes lignes à ce que nous connaissons actuellement, au niveau du tracé s'entend... Bien évidemment les routes étaient plus étroites, pas goudronnées, moins fréquentées. En revanche, il existait de nombreux chemins et sentiers qui parcouraient la montagne, et dont beaucoup ont été depuis rayés de la carte...

Depuis la plaine, qu'elle soit tarnaise ou héraultaise, c'était en 1900 une véritable expédition que de rejoindre les localités des Monts de Lacaune ou de la Montagne Noire, et on n'entreprenait le voyage que si l'on avait une bonne raison de le faire, commerciale souvent. La différence d'altitude imposait d'affronter des pentes redoutables, notamment quand la chaussée était fortement dégradée. Un climat rude, notamment de novembre à avril, y contribuait grandement, ajouté à un mauvais entretien général des routes...

A cette époque, on marchait beaucoup à pied, et le milieu rural ou montagnard accroissait les distances à parcourir. Il fallait donc partir très tôt, alors qu'il faisait encore nuit noire, pour un trajet qui pouvait durer 2 ou 3 heures (voire plus) afin de rejoindre le marché ou la foire convoités ! D'autant plus que dans l'après-midi il faudrait effectuer le chemin inverse, souvent simplement chaussés de sabots qui n'avaient rien à voir avec le confort des chaussures de randonnée actuelles...

Les premiers vélos apparurent au début des années 1900, mais cela représentait un tel investissement financier que peu de familles de la montagne pouvaient s'en offrir un. D'autant plus que le mauvais revêtement des routes locales accentuait fatigue physique et crevaisons. Sans parler du risque d'accident dans les descentes : on le voit ici à proximité d'une des premières usines hydro-électriques de la zone, au pont de Luzières, où un filet de protection avait dû être installé après plusieurs basculements de cyclistes au-dessus du parapet !...

Bien souvent, le marcheur avait fréquemment pour compagnon un animal (âne, mule, vache, plus rarement cheval ou boeuf) pour porter les charges à l'aide d'un bât parfois rudimentaire. Il est évident qu'avec de tels chargements la bête accompagnatrice ne pouvait pas servir de monture, et que l'on n'avait pas d'autres choix que de marcher à ses côtés, et de réagir à ses caprices éventuels...

Aux difficultés habituelles dues à la complexité du relief, il fallait rajouter en hiver la présence de la neige qui pouvait s'éterniser sur plusieurs mois. Il neigeait il y a un siècle beaucoup plus que de nos jours, et des couches avoisinant ou dépassant un mètre de hauteur n'étaient pas rares. Cela compliquait les tournées des facteurs du secteur, qui effectuaient fréquemment plus de 20 kilomètres quotidiens, et devaient en plus faire la trace dans la poudreuse...

Cette neige lacaunaise vit apparaître les premiers skis avant la guerre de 14. Oh, certes, nous n'étions pas dans les Alpes et cette pratique naissante, soit pour se déplacer soit comme loisir, était très confidentielle dans nos modestes montagnes. Toutefois, j'ai pu voir une carte postale (que je n'ai pu me procurer) où plusieurs skieurs évoluaient à Lacaune sous le château de Calmels dans des prairies enneigées qui ont depuis été loties. Il faut dire que Lacaune, station balnéaire dotée d'un casino, attirait une clientèle aisée pouvant accéder à ce type d'activité...

Si les charrettes étaient essentiellement utilisées pour les travaux agricoles, elles pouvaient constituer également un moyen de transport dans ces contrées où ils étaient rares et onéreux. C'était donc en charrette que les futurs vendangeurs quittaient leur montagne pour rejoindre les vignes de la plaine, après qu'ils aient refusé de s'y rendre à pied comme cela se pratiquait auparavant. On peut noter que la législation était assez libre concernant le nombre de passagers, et que leurs bagages étaient limités : pour coucher dans la paille, une seule tenue était bien suffisante !...

Afin de désenclaver les villages de montagne, un service de diligence existait pour rejoindre les villes des vallées tarnaises (Castres) et héraultaises (Lamalou). A Lacaune, c'est la famille Fusiès qui y ouvrit en premier une auberge-relais : les Fusiès s'y étaient réfugié en 1685 en raison de la révocation de l'édit de Nantes. Elle commença par convoyer des marchandises avec des voitures à chevaux.

L'entreprise de transport prit rapidement de l'importance car la montagne était très mal desservie. Les rouliers de la plaine hésitaient à s'aventurer dans le haut pays. En plus de la marchandise, la famille Fusiès assura le transport des voyageurs et du courrier. Dans le courant du XVIIIème siècle, elle participa à la création de la ligne Béziers-Lacaune-Castres...

Pour cela, il fallut établir de nombreux relais, et notamment à Brassac, Murat ou Saint-Gervais. En moyenne, il en fallait au moins tous les 8 ou 9 kilomètres. Dans chaque relais, suivant la fréquentation du chemin par les voituriers, il y avait de 10 à 20 chevaux. En général, ils attendaient tout harnachés, car il fallait perdre le moins de temps possible lors du changement de montures...

Ceux qui arrivaient se reposaient un jour ou deux avant de repartir. D'autres étaient loués par des charretiers pour venir en renfort de leurs propres bêtes : c'était tous les jours le cas à Saint-Gervais pour gravir la Croix de Mounis, ou à Saint-Pons pour monter le col du Cabarétou. En haut de la côte, les chevaux étaient relachés et regagnaient seuls leur écurie...

Au début du XIXème siècle, la famille Fusiès avait plus de 300 chevaux répartis dans leurs différents relais. Ils les achetaient au régiment de Castres, qui renouvelait régulièrement ses bêtes. Le début du XXème siècle, avec l'apparition du train, signa progressivement la disparition des véhicules à traction animale...

Le parcours était très rude aussi bien pour les chevaux que pour l'équipage : les premiers devaient tirer des voitures très lourdes et les seconds subissaient les cahots sans cesse renouvelés dus à des chaussées déformées en permanence. Pour arriver à Castres dans la matinée, la diligence devait quitter Lacaune la veille vers 23 heures et passait vers 1 heure à Brassac !...

En 1904, des diligences arrivaient à Lacaune depuis Belmont, Brassac, Montredon-Labessonnié, La Salvetat ou Saint-Gervais. Voici celle qui descendait vers l'Hérault ; elle était tirée par 5 chevaux. On remarquera la présence de passagers aussi bien dans la voiture que sur l'impériale. La bâche était sensée protéger les colis ou le courrier de la poussière. De même, le cocher et les passagers avant glissaient leurs jambes dans des sacs afin de se protéger pendant ce long voyage. Partie d'Estréchoux (en aval de Saint-Gervais) à 22 h 40, la diligence arrivait à Lacaune à 4 h 40 après avoir parcouru 42 kilomètres...

A suivre, rubrique "Haut-Languedoc d'antan (4)"...
